
Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Observations sur la Valeur Systématique de l'Ovule
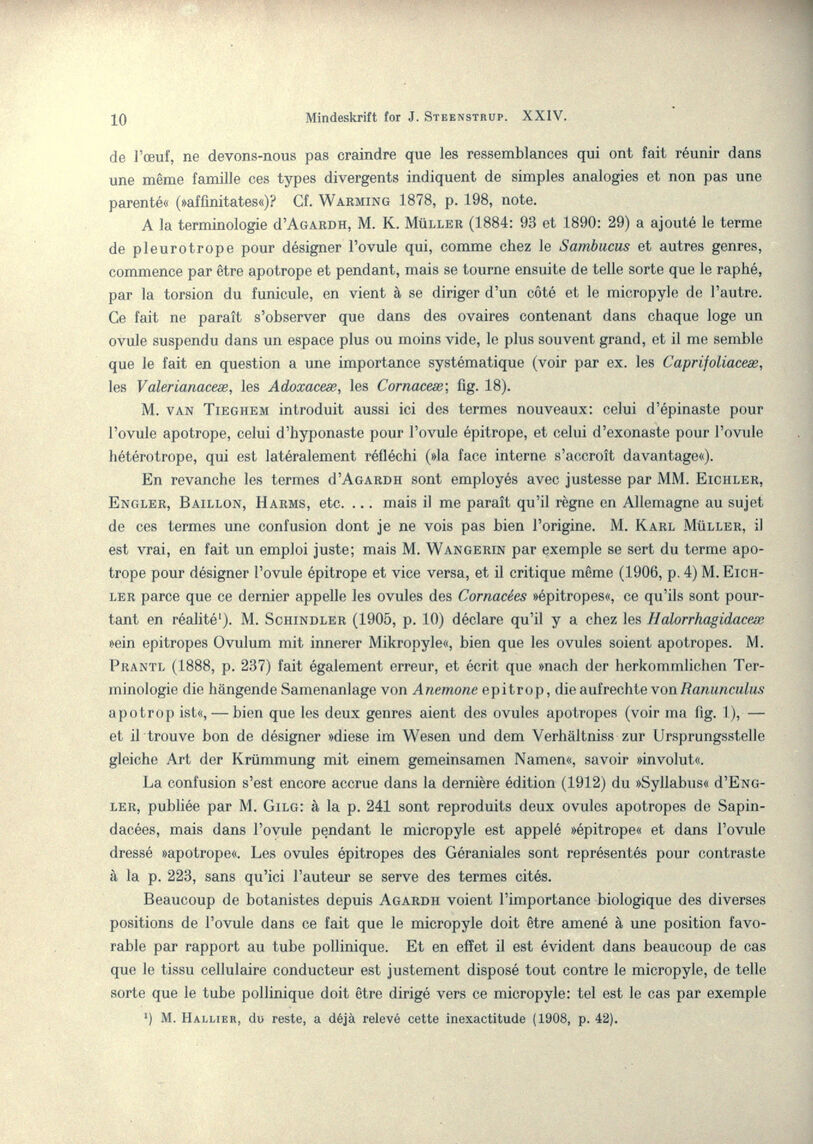
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
de l’æuf, ne devons-nous pas craindre que les ressemblances qui ont fait réunir dans
une méme famille ces types divergents indiquent de simples analogies et non pas une
parenté« (»affmitates«)? Cf. Warming 1878, p. 198, note.
A la terminologie d’AGARDH, M. K. Muller (1884: 93 et 1890: 29) a ajouté le terme
de pleurotrope pour designer Fovule qui, comme chez le Sambucus et autres genres,
commence par étre apotrope et pendant, mais se tourne ensuite de telle sorte que le raphé,
par la torsion du funicule, en vient å se diriger d’un coté et le micropyle de l’autre.
Ge fait ne parait s’observer que dans des ovaires contenant dans chaque loge un
ovule suspendu dans un espace plus ou moins vide, le plus souvent grand, et il me semble
que le fait en question a une importance systématique (voir par ex. les Caprifoliaceæ,
les Valerianaceæ, les Adoxaceæ, les Cornaceæ; fig. 18).
M. VAN TiEGHEM iutroduit aussi ici des termes nouveaux: celui d’épinaste pour
l’ovule apotrope, celui d’hyponaste pour l’ovule épitrope, et celui d’exonaste pour l’ovule
hétérotrope, qui est latéralement réfléchi (»la face interne s’accroit davantage«).
En revanche les termes d’AGARDH sont employés avec justesse par MM. Eichler,
Engler, Baillon, Harms, etc. . . . mais il me parait qu’il regne en Allemagne au sujet
de ces termes une confusion dont je ne vois pas bien l’origine. M. Karl Muller, il
est vrai, en fait un emploi juste; mais M. Wangerin par exemple se sert du terme apo-
trope pour designer l’ovule épitrope et vice versa, et il critique méme (1906, p. 4) M. Eich-
ler parce que ce dernier appelle les ovules des Cornacées »épitropes«, ce qu’ils sont pour-
tant en réalité’). M. Schindler (1905, p. 10) déclare qu’il y a chez les Halorrhagidaceæ
»ein épitropes Ovulum mit innerer Mikropyle«, bien que les ovules soient apotropes. M.
Prantl (1888, p. 237) fait également erreur, et écrit que »nach der herkommlichen Ter-
minologie die hångende Samenanlage von Anemone epitrop, die aufrechte von /?aA^^^«CM/M.9
apotrop ist«, — bien que les deux genres aient des ovules apotropes (voir ma fig. 1), —
et il trouve bon de designer »diese im Wesen und dem Verhåltniss zur Ursprungsstelle
gleiche Art der Kriimmung mit einem gemeinsamen Namen«, savoir »involut«.
La confusion s’est encore accrue dans la derniére edition (1912) du »Syllabus« d’ENG-
LER, pubhée par M. Gilg: å la p. 241 sont reproduits deux ovules apotropes de Sapin-
dacées, mais dans l’ovule pendant le micropyle est appelé »épitrope« et dans l’ovule
dressé »apotrope«. Les ovules épitropes des Géraniales sont représentés pour contraste
å la p. 223, sans qu’ici l’auteur se serve des termes cités.
Beaucoup de botanistes depuis Agardh voient l’importance biologique des diverses
positions de l’ovule dans ce fait que le micropyle doit étre amené å une position favo-
rable par rapport au tube pollinique. Et en effet il est evident dans beaucoup de cas
que le tissu cellulaire conducteur est justement disposé tout contre le micropyle, de telle
sorte que le tube pollinique doit étre dirigé vers ce micropyle: tel est le cas par exemple
1) M. Hallier, du reste, a déjå relevé cette inexactitude (1908, p. 42).
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>